Celle,
nomade, qui déclarait : « une femme a autant de patries qu’elle a
connu d’amour heureuses », pour qui Paris fut à chaque demeure l’espace
d’une province inconnue et retrouvée, s’arrêta près de vingt ans au
Palais-Royal, captive d’un « sortilège ».
Dans
ce lieu fermé, où le regard se détourne pour échapper à l’oppressante symétrie,
et vient buter sur l’alignement des fenêtres – chacun ne pouvant voir sans être
vu à sn tour –, survient la menace d’une intimité contraignante, soumise au
rythme rigoureux des lignes et des grilles. Mais l’évidence, la transparence,
nées de cette clôture, se parent aussitôt d’ambiguïté : dissimulés par la
courbe protectrice des arcades, d’obscurs passages viennent interrompre la sage
et régulière ordonnance des boutiques, les incitant à se refermer jalousement
sur leurs secrets.
Là
s’engouffrent, anonymes désormais, le passant ou l’habitant du Palais-Royal,
les rires des enfants, la rumeur de la ville et les silhouettes voûtées des
vieillards.
Ces
sombres galeries, par où l’édifice se livre au temps présent, sont les seuils
obligés d’une tradition, d’une mémoire, que rappellent curieusement d’étroites
devantures. Après le moderne « centre d’Information de la Banque de
France », l’enseigne de « l’Art au foyer » voisine avec une
« Association laitière Française », et cède la place à « la
Tapisserie au point et de
style ». Comme dans ces manuels de la « parfaite ménagère »
des années trente, sans doute accueillis par les rires insolents de
« Claudine à l’école ».
Un
rapide examen, de l’autre côté des
vitrines, vous ramène parfois sévèrement à votre condition d’intrus, et
vous commande de passer votre chemin. Alors, tout empreints d’un passé de femme
amoureuse, ces valises en crocodile, ces flacons de parfum, ces sacs en lézard
que côtoient tel manteau d’astrakan, tel tailleur Chanel, restituent le faste
troublant des années cinquante. L’œil, attiré par l’étendue souveraine que se
donne la Comédie Française, puis par la carte du Véfour que n’eut pas dédaigné
Colette, dont elle était l’habituée, s’attarde bientôt sur ces présentoirs où
se serrent timbres de collection, dont le poudroiement succède aux strictes
rangées d’innombrables médailles. Ces fragments de papier éphémères, témoins
d’une mystérieuse odyssée, ont échoué dans la pénombre pour une longue escale,
guettant le promeneur initié. Témoins d’un passé révolu, leur histoire contenue
dans une alternance éblouissante, par un classement impitoyable et par un
rituel d’échanges secrets, ils incarnent le paradoxe qui donne au Palais-Royal
sa magie.
Dans
ce « village dans la ville », navire amarré au cœur de l’océan
parisien, Colette, immobile à sa fenêtre comme au gouvernail, entame la
dernière traversée de sa longue vie. D’un capitaine, son père, elle gardera le
goût de dormir « la tête dans les étoiles » ; au chevet de son
lit, qu’elle appelle son « divan-radeau », veillent un baromètre et
le célèbre fanal bleu. Mais, nous dit-elle, dans ce lieu où pourtant tout lui est
spectacle « au lieu d’aborder des îles, je vogue donc vers ce large
où ne parvient que le bruit solitaire du cœur, pareil à celui du ressac ».
Ainsi s’amenuise l’aire d’un esprit libre et vagabond, pour mieux s’ouvrir sur
l’immensité de sa mémoire.
A
l’abri de ses « coquilles » - le Palais-Royal, puis le lit -, dans
« l’enclos » de sa chambre où la lumière forme un « cirque
protecteur » elle poursuit plus intensément son travail d’anamnèse,
entrepris depuis toujours, depuis le premier exil dans le sombre entresol de la
rue Jacob où « ce grand mal, la vie citadine, ne pouvait durer, il serait
guéri miraculeusement par ma mort et ma résurrection, par un choc qui me
rendrait à la maison natale, au jardin et abolirait tout ce que le mariage
m’avait appris ».
Toutes
les déchirures à venir, toutes les blessures amoureuses raviveront cette
rupture avec le paradis perdu de l’enfance, « refuge solitaire et
orgueilleux », « citadelle ».
Le
difficile apprentissage de l’amour, de l’esseulement, lui fera découvrir des
« loisirs longs et protégés comme ceux des prisonniers », et des
« repos d’infirme », ponctués par la nécessité d’écrire - rideaux tirés en plein jour -, et
cela bien avant que l’arthrose ne la rive à sa chambre.
A
celle qui n’est capable de fantaisie que dans l’ordre, et qui conçoit la
« virtuosité » du souvenir comme un libre jeu, une flânerie
contemplative, il fallait cet espace clos du Palais-Royal dont les arcades sont
« mystérieusement pareilles, et plus mystérieusement dissemblables ».
Sur
ce fond d’apparente uniformité peut alors surgir la différence, la fantaisie,
et le détail qui la plonge « dans le jardin embroussaillé » de son
enfance, calque dont elle ne se sépare plus.
Dotée
d’une mémoire des sens peu commune, toujours à l’écoute de ses pulsions,
entraînée par une insatiable curiosité, elle tente de décrire et de maîtriser
ce qu’elle voit, ce qu’elle sent, ce qu’elle savoure, dans cette écriture que
cisèle une exigence absolue. Loin d’elle les idées générales, les vérités
éternelles : Colette est l’écrivain de la différence, pour qui la seule
restitution d’un désir, d’un souvenir dans sa totalité est une tâche impossible
et infinie. L’extraordinaire précision du détail et l’isolement inhabituel des
sensations prodiguent cet effet de familiarité, doublé d’étrangeté, qui permet
à nos propres souvenirs d’affleurer.
Au-delà
de l’illusoire possession amoureuse et de la jubilation des sens, Colette
patiemment, constamment, s’emploie à savoir « attendre (…), reconstruire,
recoller, redorer ». Au plus près de la séparation, des fractures de
l’être, sans jamais céder à l’inconvenance du tragique, cette « casanière
errante » observe la vie passagère d’une plante, d’un animal, d’un ciel.
« Regarde ! »
lui disait Sido, et du spectacle de l’univers elle s’attache à ce qui s’en dérobe
avec la fascination du collectionneur.
De
ses beaux yeux pers, soulignés de khôl, à l’heure où les perspectives du
Palais-Royal s’obscurcissent, elle contemple ses sulfures dont la sphère de
cristal est « abîme, piège des images, ressource de l’esprit las,
génératrice de chimères » et « n’a pas fini de tenter
mystérieusement l’homme ».
Elle
sait qu’entre ce qui se donne à voir et le regard qui veut capturer, il y a
l’espace d’une abolition où s’inscrit l’inaccessibilité dernière des choses.
« Tout
change » écrit-elle, si je détourne un moment les yeux. La vie d’un être à
peu près immobile est un tourbillon de hâte et de variété ».
Défi
du désir pour ce monde inépuisable, à la mesure de son formidable appétit de
vivre que guide une rare intelligence du renoncement.


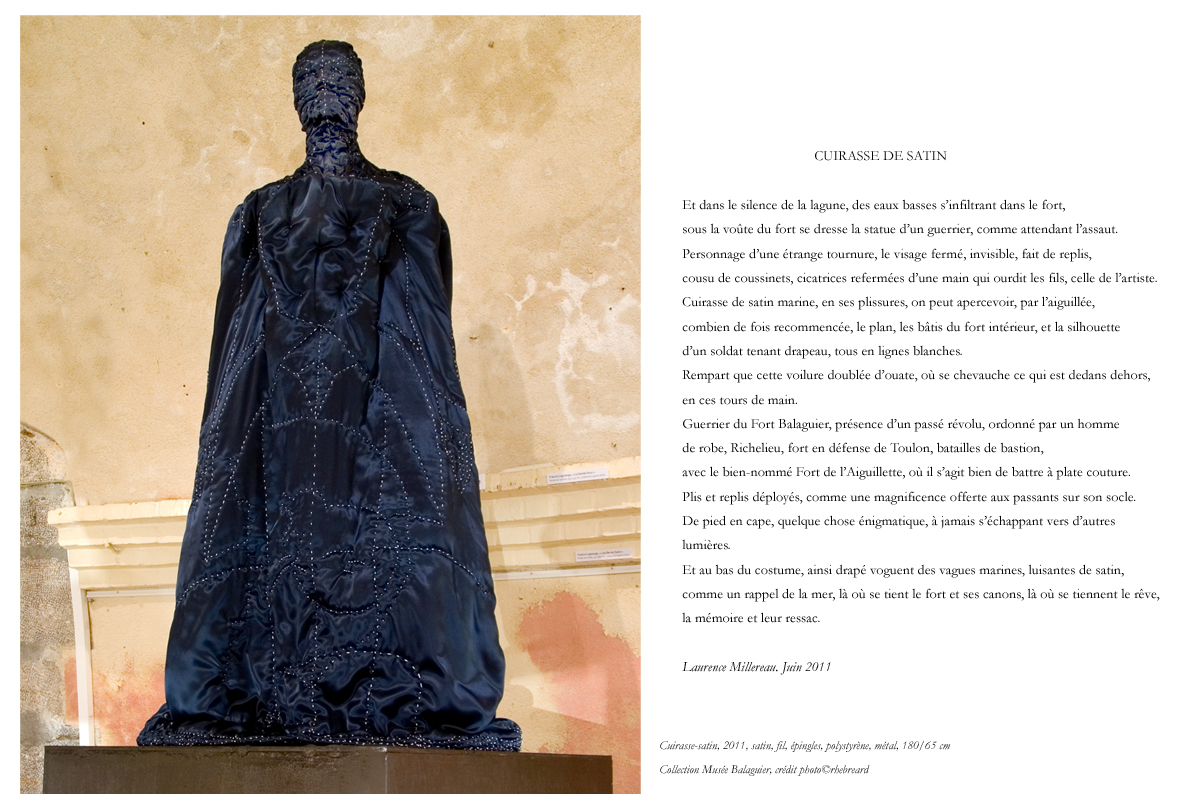
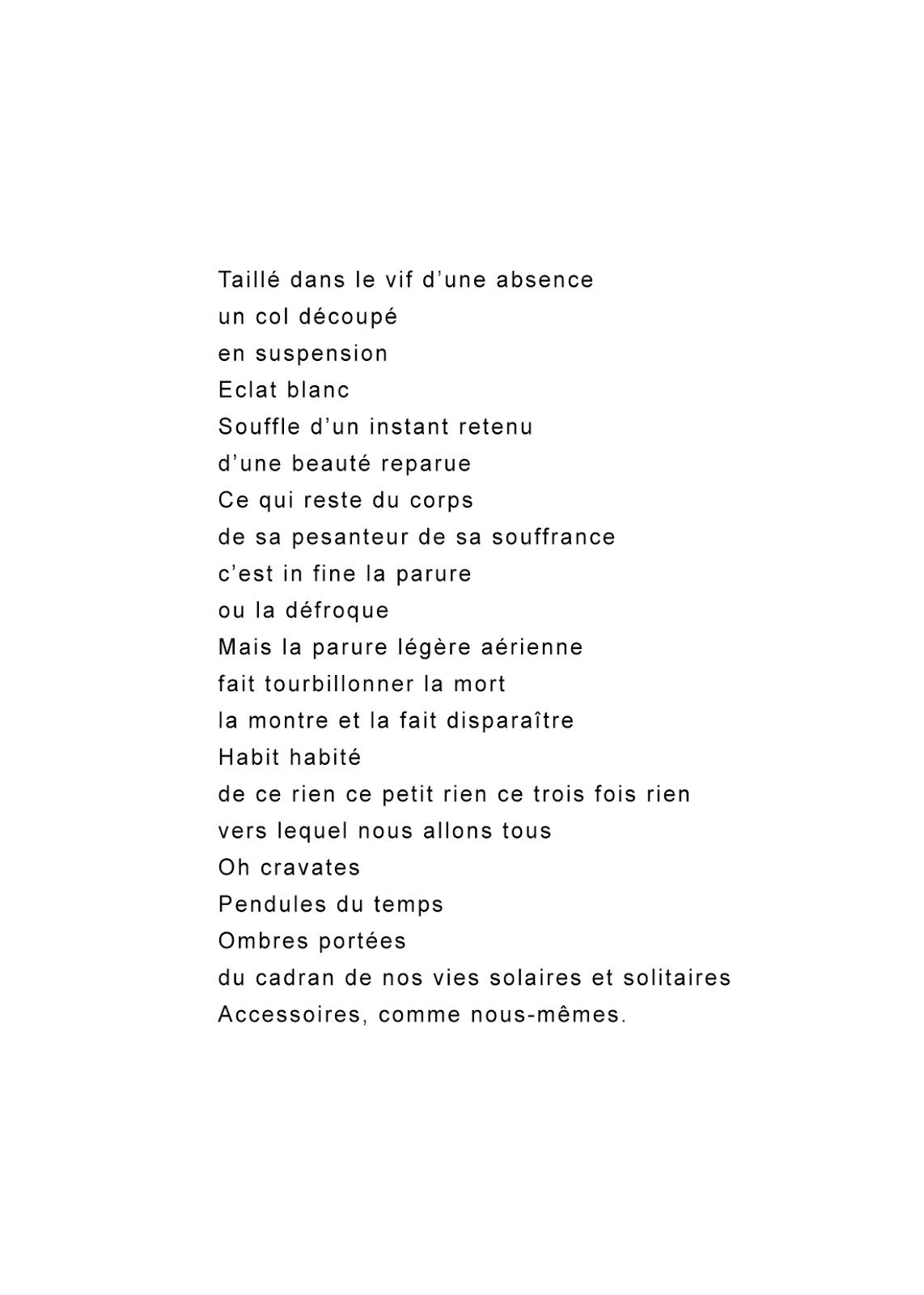

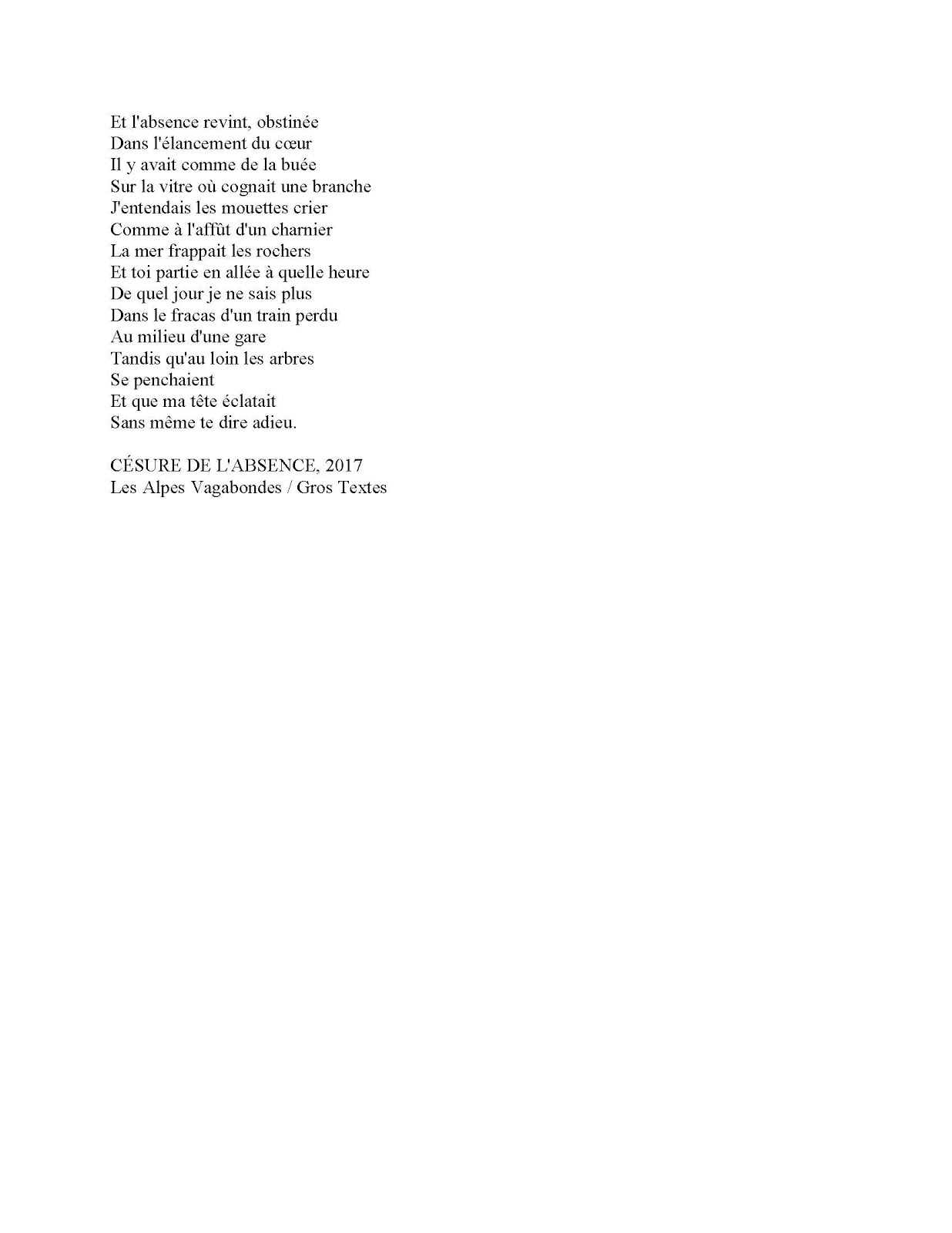
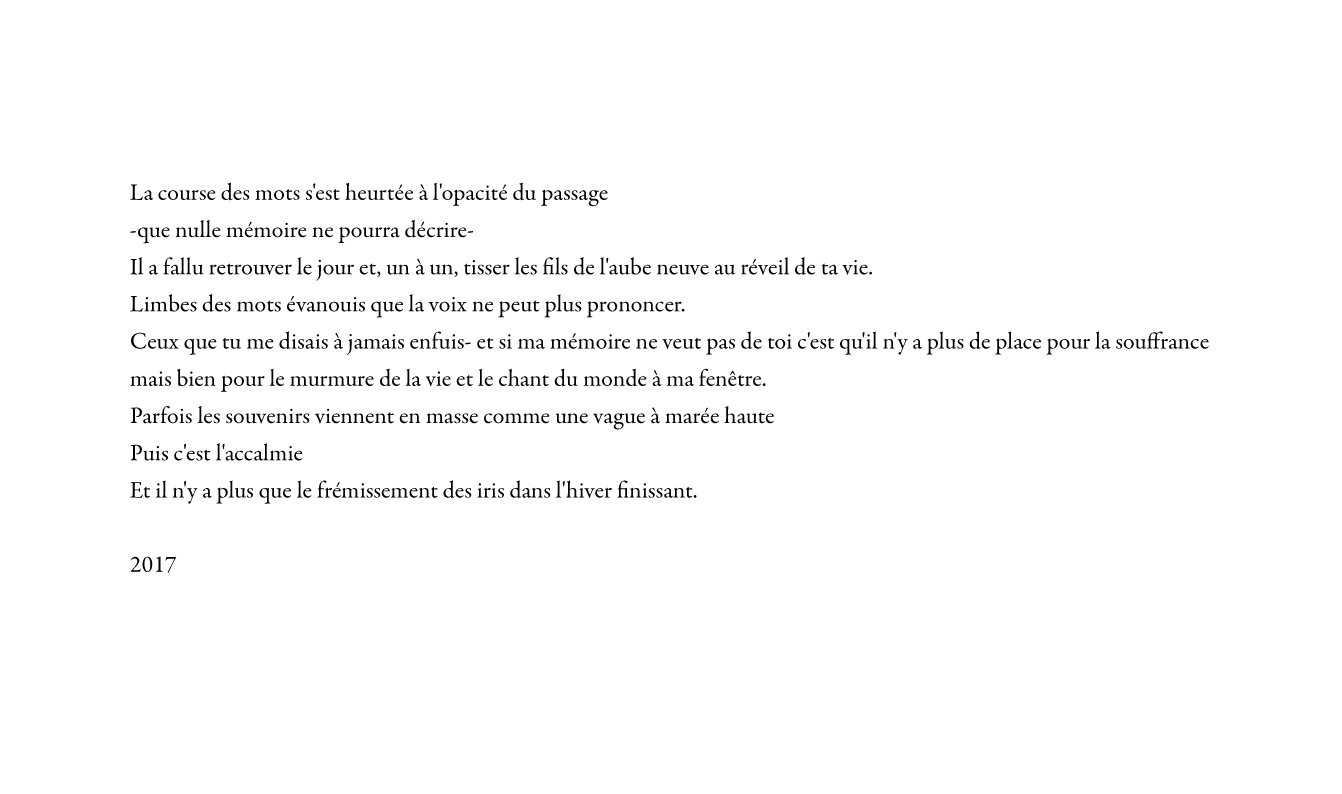
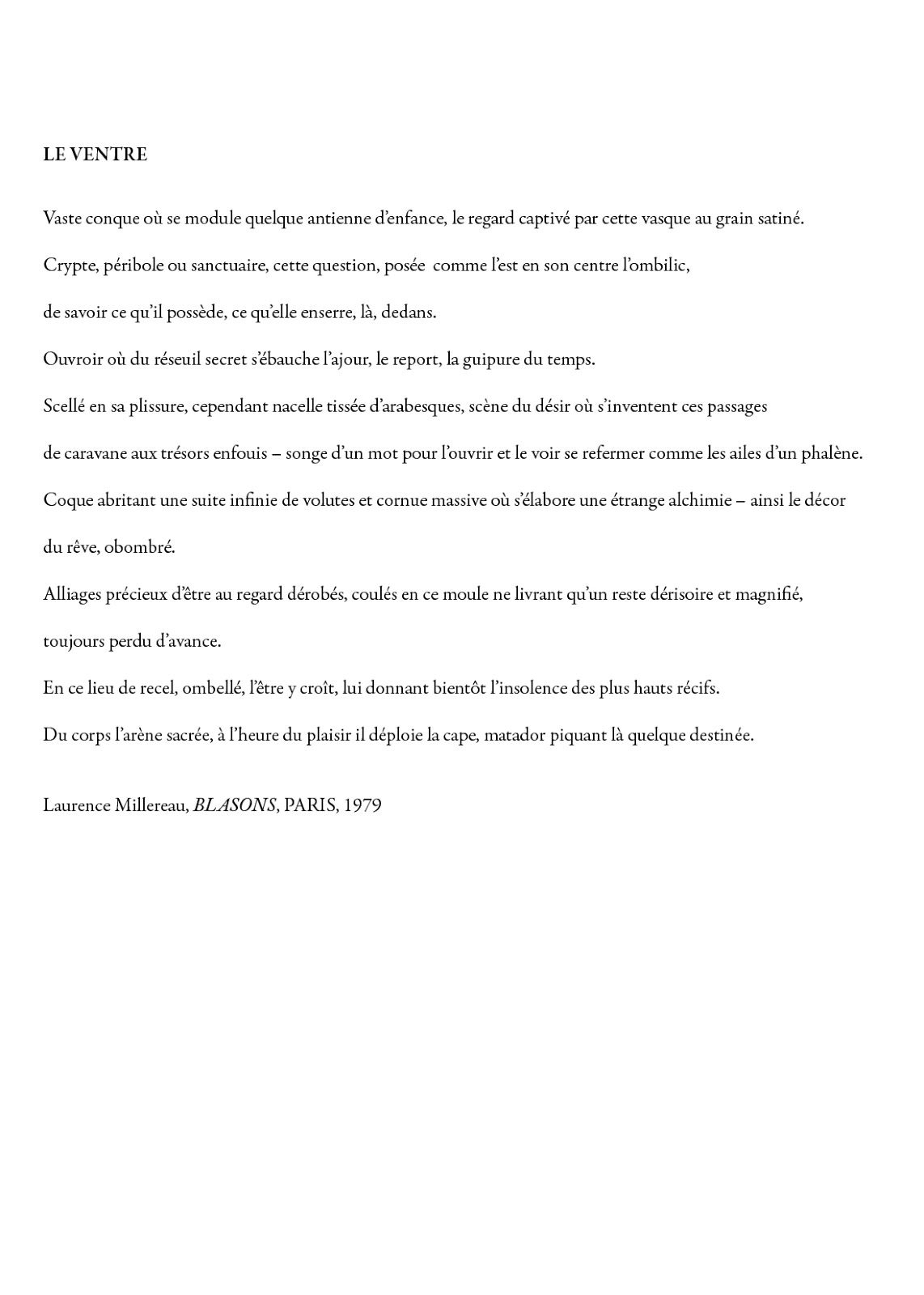
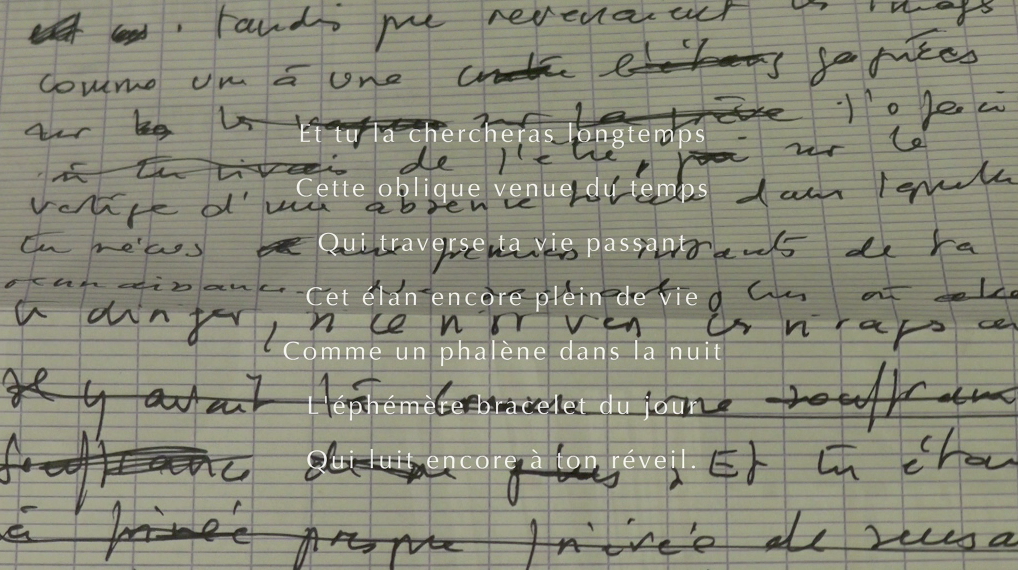
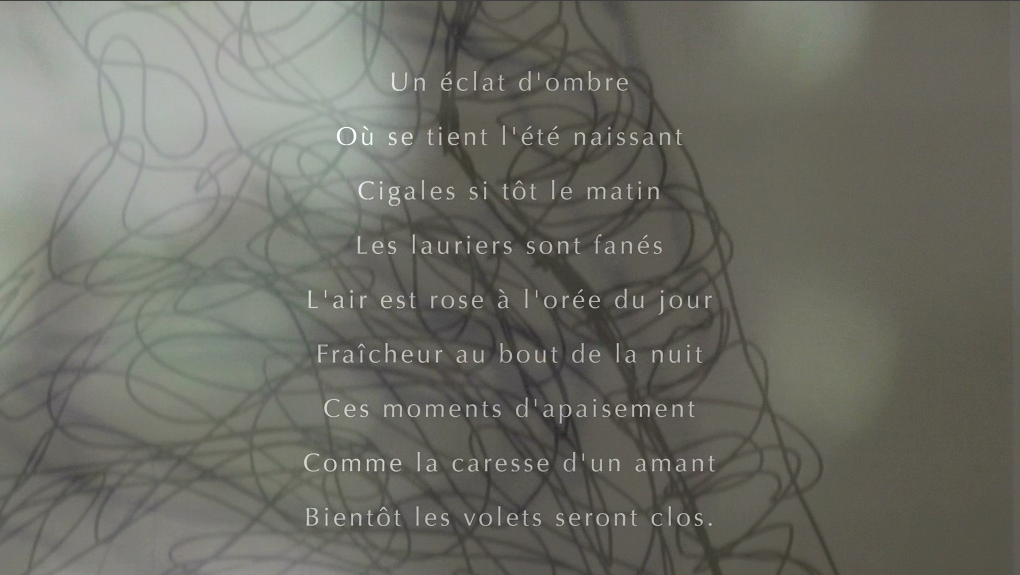


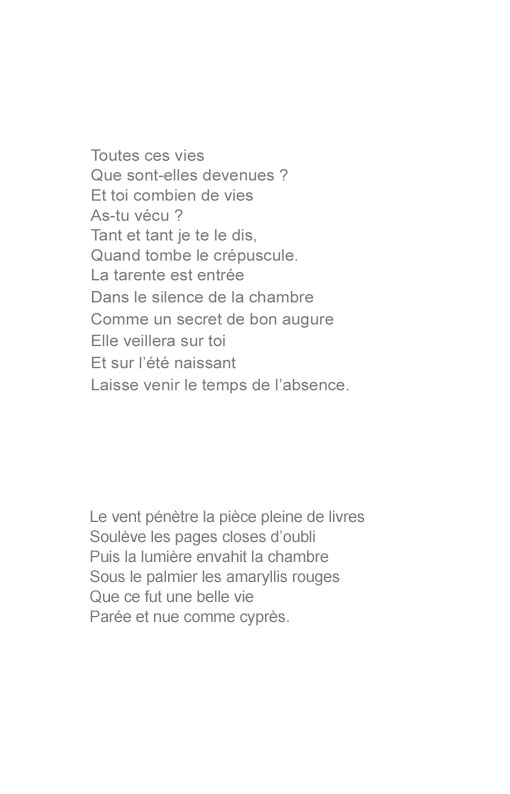
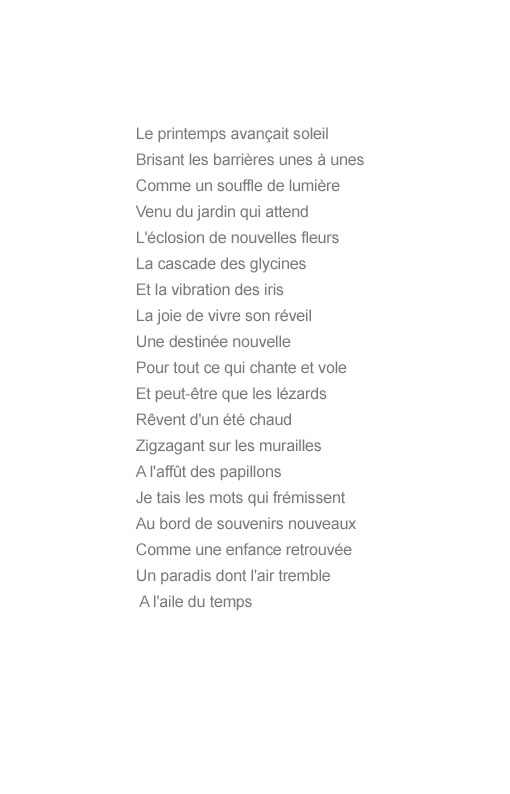
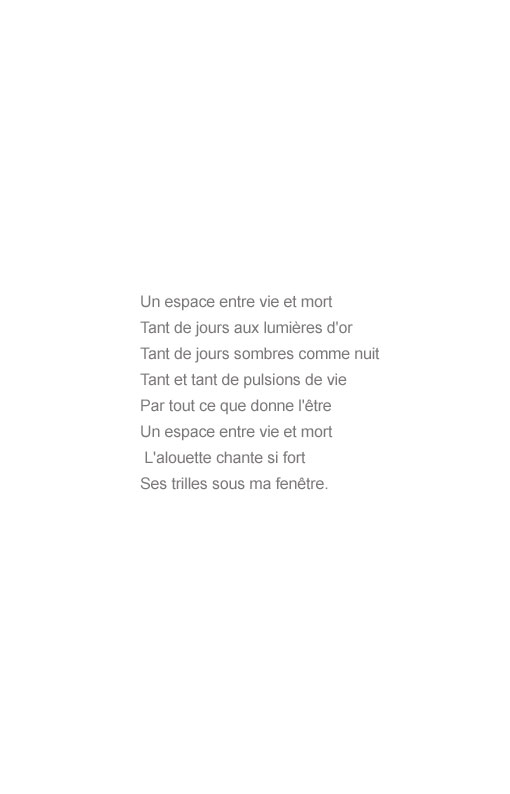
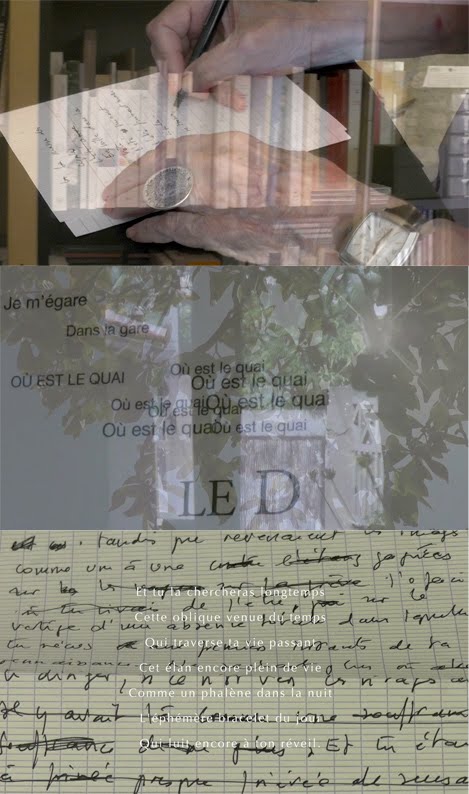


















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire